By: Prof. Monique Chemillier-Gendreau*.
Le conflit israélo-palestinien est emblématique de la crise profonde du droit international. Ce conflit revêt de multiples aspects et les négociations dites « de paix » n’ont été jusqu’ici qu’une succession d’échecs ou d’esquives couvertes par la communauté internationale. Le noeud de la difficulté, dont tous les autres aspects découlent, se trouve dans la question de la terre. Les extrémistes qui portent le projet sioniste depuis sa création n’ont eu en vue que l’accaparement complet de la Palestine par évincement des Palestiniens. Selon ce projet, le peuple palestinien doit s’effacer devant le peuple juif, lequel est persuadé d’avoir sur la terre un droit légitime puisé à des sources historico-religieuses. Ce projet a gangrené la société israélienne au point que les éléments laïques qu’elle inclut se laissent entraîner à le partager ou à le subir sans réaction suffisante.
Ce qui apparaît comme étant les points d’achoppement du règlement du conflit ne sont que des variations autour de cette question. Il en va ainsi de la concurrence sur Jérusalem et la judaïsation de la ville arabe, de l’extension des colonies de peuplement illégales sur le territoire palestinien occupé, du tabou imposé sur le droit au retour et des réticences extrêmesà prendre en considération le problème des réparations dues aux réfugiés et à toutes les victimes des exactions commises par Israël. Ce sont là les différentes facettes d’une même politique, celle de l’élimination d’un peuple de sa propre terre par destruction de ce peuple s’il le faut. De ces différentes difficultés, celle sur le droit au retour a fini par envahir le paysage comme une « question insoluble », éclipsant ainsi le problème dit des « compensations » ou faisant de lui un problème dérivé alors qu’il s’agit d’une question en soi.
Les mots sont lourds de signification et le terme de « compensation » employé à dessein, fausse l’approche du problème. Il renvoie à l’idée de marchandage : des torts reconnus du bout des lèvres d’un côté, une somme globalement calculée de l’autre. Il évite la perspective juridique qui, sauf à perdre son sens, reste fondée sur l’idée de justice. Or ce sontdes réparations au sens juridique du terme qu’il faut exiger, des réparations de guerre, des réparations pour crimes. Tout autre approche ouvrant la voie au rapport de forces dans toutes ses dimensions, s’enlisera, comme cela a été le cas jusqu’ici, dans les marécages d’arguties fondées pour les auteurs des actes incriminés sur la volonté d’en éviter les conséquences.
On reviendra donc sur ces difficultés en examinant successivement les différentes données du problème. Les faits créateurs de la situation et leur qualification en droit, la persistance de ces faits à travers le temps, la nature et le contenu des règles du droit international applicables à cette question, l’autonomie du droit à « compensation » par rapport au droit au retour et les défaillances des mécanismes d’application du droit international expliquant l’échec des tentatives esquissées pour résoudre le problème, tels sont les points qui seront examinés ci-dessous.
I- Des faits imputables à Israël ont jeté violemment les populations palestiniennes hors de leur pays en les dépossédant, ou les ont simplement dépossédées lorsqu’elles restaient sur place, sans reconnaissance ensuite des droits qui découlaient de cette situation et qui résultent pourtant des règles élémentaires des principes de la responsabilité. Ces faits sont constitutifs de crimes internationaux. Il est d’une extrême importance de rappeler ce point, car la volonté de l’escamoter permet de dédramatiser la question des compensations et d’oublier que ces crimes n’ont été jusqu’ici ni réparés, ni indemnisés.
La présentation mensongère des évènements de 1947-48-49, qui a longtemps occulté la réalité est maintenant dénoncée. Il est prouvé désormais que les mouvements juifs extrémistes de l’époque, Irgoun ou Stern, perpétrèrent alors avec la complaisance active ou passive de la Haganah des massacres qui furent accompagnés de mesures d’expulsion plus ou moins forcées et brutales selon les cas. L’exode considérable des populations arabes fuyant leurs villes ou leurs villages (700 000 à 800 000 personnes) fut ensuite rendu irréversible par une politique systématique de la part d’Israël dépouillant ces populations de leurs biens et s’appliquant à rendre leur retour impossible. Pendant longtemps, la thèse israélienne d’un départ volontaire des habitants arabes, encouragés à le faire par les autorités locales, s’est développée sans que les intéressés puissent s’y opposer, faute de preuves que les circonstances dramatiques ne leur avaient pas permis de conserver et par manque d’autorité pour se faire entendre. Dans les années 80, l’ouverture des archives israéliennes et l’intégrité intellectuelle de certains historiens israéliens ont permis de faire la lumière sur les faits. Et la
connaissance approfondie de ces faits permet aujourd’hui de procéder avec exactitude à leur qualification juridique.
Le contexte était celui, non pas de l’application du plan de partage proposé par les Nations Unies à travers la Résolution 181, mais, au-delà de ce plan, d’une prise de terres beaucoup plus large par les tenants du sionisme décidés à mettre en oeuvre à leur profit la formule qu’ils avaient forgée : « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». On ne refera pas ici une description détaillée des évènements, laquelle est maintenant bien connue. Leur bilan pour les Palestiniens se solde par des massacres, une expulsion massive menée avec des moyens militaires auxquels contribuèrent les Forces Britanniques6 et enfin desmesures irréversibles de nature à rendre le retour impossible. Destructions de maisons, occupation de terres, implantations des populations juives en lieu et place des Palestiniens, loi sur les « absents » permettant de confisquer « légalement » les biens des expulsés et gel des comptes arabes furent ainsi mis au service du projet d’expansion d’Israël.
Ces faits n’ont pas été des éléments accidentels rendus inévitables par les circonstances d’une guerre. L’intentionnalité, facteur déterminant pour procéder à la qualification en droit, est présente tout au long des évènements et persiste d’ailleurs après la guerre. D’une part, les violences faites aux Arabes étaient encouragées par les chefs comme cela a été observé, d’autre part, l’expulsion n’a pas été une conséquence collatérale de la guerre, elle en a été le but. Le transfert des populations arabes, déjà entériné par la Commission Peel en 1937, a été pensé dans les années 37-47 et il est central dans la politique de Ben Gourion. L’expulsion est ensuite restée l’objectif de la politique israélienne et s’est concrétisée à travers d’autres épisodes de massacres comme ceux de 1953 à Qibya, de Kafr Kassem en 1956, de Sabra et Chatila en 1982 ou plus récemment de Jénine en 2002. À Gaza en 2009 et depuis, c’est un enfermement meurtrier qui s’applique à des populations impossibles à expulser, sauf à les jeter à la mer.
La violence des actes, combinée à la volonté programmée de les commettre, permet de les qualifier juridiquement. Mais quel est alors le droit de référence ? La période pendant laquelle ces événements se sont déroulés, celle de la fin de l’année 1947 et des années 48-49 a été une période cruciale pour le droit international. En effet, les différentes catégories de crimes internationaux sont à ce moment-là déjà entrées dans le droit positif. Ces notions apparaissent dès les Conférences de la Paix de 1899 et 1907 qui produisent les Régulations de La Haye dans lesquelles on trouve déjà la prohibition, en situation de guerre, de toute confiscation de bien privé ou public qui ne serait pas justifiée par des nécessités militaires. Elles sont précisées par les Conventions de Genève de 1929 qu’Israël ratifia le 3 août 1948. Et après la Seconde Guerre Mondiale, des progrès notoires sont accomplis avec d’une part, la Charte des Nations Unies qui fonde le crime d’agression et encourage plus généralement les développements du droit international et d’autre part, avec l’expérience du Tribunal de Nuremberg créé par l’Acte de Londres du 8 août 1945 dont le statut définit les crimes internationaux et les applique à l’Allemagne nazie. L’Assemblée Générale des Nations Unies, en décembre 1946, consacre solennellement ce droit de Nuremberg, inscrivant ainsi son apport dans la formation coutumière du droit. Ainsi, pendant la première phase du conflit israélo-palestinien, celle qui donnera naissance au problème des torts causés à la population palestinienne, un corpus de normes existe déjà.
La longue série d’actes imputables à divers responsables politiques et militaires de l’État Hébreu relève bien de la catégorie des crimes de guerre au regard du droit de l’époque. Cette catégorie inclut en effet les pillages, la prise de butin et les confiscations de propriété. Comme tels, ces crimes doivent être jugés et ouvrir un droit à réparation. On citera les assassinats individuels, les massacres, les mauvais traitements, la déportation des populations civiles, les pillages, la confiscation des biens, la destruction de villes ou de villages sansjustification militaire, les dévastations. Tous ces actes dont les Palestiniens ont été victimes étaient en 1947-1948-49 déjà interdits par le droit international, conventionnel et coutumier. Mais de surcroît la notion de crimes contre l’humanité avait fait son apparition avec le Statut de Nuremberg. Cette qualification s’applique à des actes d’inhumanité d’une particulière gravité lorsqu’ils sont perpétrés dans l’intention de détruire une population dans son ensemble par des attaques systématiques et généralisées. La politique de répression menée par Israël, agissant comme État, a été pensée dès l’origine et a visé la population arabe de Palestine contre laquelle ont été dirigés les massacres, les actes de déportation et de dépossession de biens. Et l’on est fondé à considérer, en fonction du droit de l’époque, que les actes subis par les Palestiniens ont été constitutifs de crimes contre l’humanité compte tenu de la nature inhumaine de ces actes et de l’intention délibérée exprimée par leurs auteurs. Ces conclusions en matière de qualification sont au centre de la question d’un droit à réparation ici posée et les développements consacrés ci-dessus ne sont pas inutiles ousuperflus. En effet ce n’est qu’en qualifiant d’abord avec exactitude les faits incriminés que l’on peut ensuite poursuivre le raisonnement sur les conséquences à en tirer. Dans la théorie contemporaine du droit international, les crimes internationaux doivent être sanctionnés mais ils doivent aussi être réparés. La notion de réparation a été incorporée aux Statuts des Tribunaux pénaux Internationaux, comme à celui de la Cour pénale Internationale. Cette dernière peut ordonner en faveur des victimes des mesures de restitution, mais également d’indemnisation et de réhabilitation. Or, Israël a toujours tenté d’opposer des arguties diversesà cette application exigeante du droit pour échapper à toute reconnaissance de saresponsabilité. Et en entrant dans une négociation politique sur un projet de « compensation », les Palestiniens ont pris le risque de s’éloigner de l’approche juridique de la question qui est pourtant leur seul rempart. Pour éviter d’être contraintes au devoir de réparation, les autorités israéliennes ont mis en avant des arguments de droit intertemporel dans une conception erronée de celui-ci qu’il faut dénoncer avant de poursuivre.
II- La persistance des faits et de leurs conséquences à travers le temps influence les modalités d’application des normes juridiques. Les règles de droit s’appliquent aux situations factuelles ratione temporis. Cela signifie qu’il faut vérifier quel était le droit en vigueur au moment des faits pour en déduire l’application de la norme, mais aussi qu’il est nécessaire d’observer quelle a été l’évolution du droit par rapport à la continuité des faits pour en tirer toutes les conséquences. Le maintien d’un droit apprécié à une certaine époque dépend des règles en vigueur au moment de la naissance de ce droit, mais aussi des règles telles qu’elles ont évolué parallèlement à la situation de fait. Pour refuser tout droit aux expulsés de 1948 Israël prétend qu’il n’y avait pas selon le droit international de l’époque de devoir de rapatriement qu’il aurait dû respecter, ou tout autre devoir de restitution ou réparation pour le tort qui leur aurait été fait, puisque selon ce raisonnement, il n’y aurait pas eu de tort au regard des règles de cette période. Il a été montré à juste titre combien ce raisonnement était erroné. Il y avait bien déjà, au moment où se sont produits les premiersfaits (1947-1948), des normes coutumières établissant le droit des Palestiniens de ne pas être expulsés. Et, plusieurs niveaux de raisonnement sont à cumuler ici qui permettent de conclure à la pleine application du droit contemporain à la situation faite aux Palestiniens depuis les derniers mois de 1947.
Il est vrai que la norme juridique ne peut pas être rétroactive. Mais lorsque l’on se trouve devant un processus de formation coutumière, l’application correcte du droit à des faits datés précisément requiert de se référer au moment de cristallisation de la coutume. C’est ce qu’ont fait les juges de Nuremberg pour répondre aux avocats des Nazis qui prétendaient qu’au moment des faits, les actes incriminés ne tombaient pas sous le coup de la norme d’interdiction. Selon les juges, la norme formalisée dans le Statut du Tribunal existaitantérieurement sous forme coutumière, c’est pourquoi ils pouvaient l’appliquer. S’il est vrai que les Conventions de Genève sur le droit humanitaire en cas de conflit armé du 12 août 1949 codifiant de manière approfondie les droits des populations civiles durant la guerre, n’étaient pas encore en vigueur au moment des exactions commises contre les Palestiniens dans la première guerre israélo-arabe, les normes de protection qu’elles ont cristallisées, existaient, nous l’avons dit, sous forme coutumière à travers le « droit de La Haye » et le « droit de Nuremberg ».
De même que le droit se forme à travers un processus continu, de même des crimes peuvent-ils se perpétrer à travers une longue période et se présenter comme des faits continus. Le fait criminel de l’expulsion ou de la dépossession a pris sa source pour chaque Palestinien au moment où celui-ci a été mis dans l’obligation de quitter ses foyers ou a été privé de ses biens par la force. Mais ce fait criminel se prolonge dans le temps tant que leretour n’est pas rendu possible, le tort compensé et les biens restitués. Il s’agit d’une infraction internationale permanente. Pour les torts faits aux Palestiniens, cette continuité s’étale sur plus de six décennies. Il est alors impossible de placer le fait incriminé exclusivement sous le régime juridique en vigueur au moment de son origine. Si le régime derépression de ces crimes a été renforcé au cours du temps, le crime est « rattrapé » par les progrès du droit qui s’appliquent au fur et à mesure de leur développement à la continuité du fait. C’est ainsi que si, pour des faits commis en 1947, 1948 ou 1949, il était justifié de rechercher quel était alors le droit en vigueur (et l’on a vu que ces faits relevaient déjà de catégories interdites), il est également justifié d’appliquer aux mêmes faits qui se prolongent dans le temps, les normes nouvelles élaborées pour la répression de ces faits. Ainsi un expulsé de 1948 qui n’a pas bénéficié du droit au retour, ni d’aucune réparation depuis cette date, reste aujourd’hui un expulsé et ses droits se définissent par rapport aux normes aujourd’hui en vigueur. Si les normes se sont développées, la répression doit être renforcée en fonction des avancées du droit. De surcroît, le passage du temps en prolongeant le tort sans qu’il soit réparé, augmente les indemnités qui seront dues, car la durée du dommage doit être prise en compte dans le calcul du montant de la réparation.
Ce constat est considérablement confirmé par le régime du droit impératif général. Au nom de celui-ci, même s’il ne s’agissait pas de faits continus, les actes criminels d’hier tombent sous le coup des normes établies aujourd’hui pour les sanctionner. Le droit impératif général correspond aux normes supérieures et indérogeables qui structurent une société en exprimant les valeurs qui la fondent. Longtemps hétérogène et constituée d’une juxtaposition de sociétés différentes, la société mondiale a connu à partir du XXè siècle une intégration de plus en plus poussée. Des valeurs communes se sont alors dégagées. La Convention de Vienne sur le droit des traités en a établi le régime juridique avec des dispositions dont l’application va au-delà de la question des traités. Il en résulte qu’une norme impérative annule tout autre norme lui étant contraire. Mais il en résulte aussi que si une nouvelle norme de droit impératif survient, elle s’applique aux situations antérieures.
Ainsi la combinaison de deux arguments conduit-elle à appliquer aux torts et dommages causés aux Palestiniens à partir de la fin de 1947 et tout au long des années qui ont suivi les normes les plus élevées du droit international concernant la répression des faits commis. D’une part, ces faits sont qualifiables de crimes internationaux (crimes de guerre et crimes contre l’humanité) et à ce titre, ils sont imprescriptibles et les poursuites contre leurs auteurs et les requêtes pour réparations peuvent être ouvertes sans considération de temps. Ainsi le veut le régime juridique de ces crimes reconnu depuis le Statut du Tribunal de Nuremberg, confirmé dans les Statuts des Tribunaux Pénaux Internationaux et de la Cour Pénale Internationale, ainsi que dans bien des législations internes. D’autre part, les normesconcernant la protection des droits de l’homme, le droit humanitaire en cas de conflits armés et le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes avec toutes ses conséquences, appartiennent à la catégorie des normes de droit impératif général (jus cogens). De ce fait, tout progrès dans cet ensemble de normes s’applique aux situations perdurant aujourd’hui comme violations des droits reconnus, quelle que soit la date de naissance de ces situations. Le droit international humanitaire requiert un comportement actif de tous les gouvernements des États Parties aux Conventions (ce qui est le cas d’Israël) pour ne pascommettre de violations ou pour faire cesser celles dont ils ont connaissance. Chaque gouvernement a l’obligation d’agir et ne pas le faire est constitutif d’un manquement de nature à engager sa responsabilité. Telle est la situation d’Israël qui a manqué à son devoir de respecter et faire respecter (notamment par les agents placés sous son autorité) les obligations constitutives du droit humanitaire.
III- Les considérations qui précédent permettent de mieux cerner l’ensemble des règles applicables à la situation des Palestiniens qui ont été expulsés de leurs foyers et (ou) privés de leurs biens depuis les derniers mois de 1947 jusqu’à nos jours. Les actes incriminés sont des faits illicites au regard du droit international, plus précisément des crimes internationaux imprescriptibles relevant du corpus contemporain des droits de l’homme et du droit humanitaire. L’ensemble du droit international en vigueur s’applique à ces actes aux effets continus, indépendamment de leur date d’origine.
Ce droit est la combinaison de règles de fond d’ordre primaire interdisant certains comportements et de règles secondaires, mettant en oeuvre le principe de responsabilité de l’auteur des actes et celui qui en découle de réparations pour les torts subis par les victimes. Or, les règles concernant la responsabilité des États pour faits illicites au regard du droit international sont bien établies. Cette responsabilité pour violation du droit humanitaire a été reconnue par la Cour Internationale de Justice qui déjà en 1986 avait condamné un gouvernement pour « encouragement » à commettre des actes contraires aux principes généraux du droit humanitaire. C’est dire si un gouvernement qui n’en est pas à encourager des tiers mais exécute lui-même les actes interdits, tombe sous le coup de la responsabilité de l’État pour violation de ses obligations internationales.
Cette responsabilité a d’ailleurs été renforcée par les travaux de la Commission duDroit International. Son projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait illicite a été adopté par l’Assemblée générale et annexé à une résolution du 12 décembre 2001 consolidant ainsi la construction coutumière du droit de la responsabilité . Il est désormais admis que tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale (article 1), qu’il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission constitue une violation d’une obligation internationale de l’État (article 2), que le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international, indépendamment de la position qu’occupe cet organe (article 4), que la responsabilité internationale de l’État peut faire naître directement des droits au profit d’une personne ou d’une entité autre qu’un État (article 33) et aussi qu’un État responsable d’un fait illicite est soumis à l’obligation de restitution (article 35).
Complétant ces progrès, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 16 décembre 2005 une résolution concernant le droit à un recours et à réparations des victimes des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire. Elle ouvre un champ nouveau à la lutte contre l’impunité et constitue un complément au droit de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Elle déclare que les États ont l’obligation de mettre leur droit interne en conformité avec leurs obligations internationales en la matière, car les victimes doivent pouvoirbénéficier d’un accès effectif à la justice, de recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris leur permettant d’obtenir réparation. L’apport capital de ce texte est dans l’affirmation que le droit de la responsabilité internationale n’est plus seulement un droit entreÉtats, mais qu’il concerne aussi les personnes privées, individuellement ou en groupe, qui peuvent le faire valoir à leur profit. Les victimes, ici les Palestiniens, comme individus et comme peuple, se voient par ce texte, confirmés dans leur droit à réparation et à un recours pour faire valoir ce droit. Non seulement Israël n’a pas suivi les recommandations de cette résolution, mais à l’opposé, Israël a instrumentalisé sa législation, notamment avec la loi des absents et bien d’autres mesures prises pour légaliser dans son droit interne la dépossession des Palestiniens.
Cet ensemble normatif est, dans le cas qui nous préoccupe ici, complété par des résolutions précises, visant le droit à réparations pour les réfugiés palestiniens. On ne peut les citer toutes tant elles sont nombreuses depuis la résolution 194 de l’Assemblée générale, texte
fondateur des droits des réfugiés palestiniens. Dès 1948, les Nations Unies fixaient en effet lecadre juridique du principe d’indemnisation : «… Il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables ». Et depuis cette date, l’Assembléegénérale n’a cessé de réitérer l’exigence d’application de la résolution 194 et des principes qu’elle affirme. Le Conseil de sécurité lui-même, dans la résolution 46 de 1948 demande « to refrain….from any political activity which might prejudice the rights, claims or positions of either community ».
IV- Ainsi, tout concorde pour faire valoir un droit à réparation pour tous les Palestiniens, victimes depuis la première guerre israélo-arabe de violations de leurs droits. Encore faut-il préciser quel est exactement l’objet de la réparation. Par un raisonnement contestable, le droit à restitution ou réparation est devenu un droit à compensation généralement discuté en relation avec le droit au retour ou, en tout cas, avec la notion de réfugié. Or, il est important d’établir ici des distinctions rigoureuses. Le droit à « compensation » peut être compris comme une formule générale qui recouvrirait le droit à réparations. Si celle-ci consistant en la restitution des biens non retrouvés et la restauration de la situation perdue n’est pas possible pour des raisons concrètes, alors la réparation des torts causés est opérée à travers un équivalent monétaire.
La nécessité d’un processus de réparations est dans bien des cas lié à l’expulsion, maispeut en être indépendant. En effet, toutes les victimes des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire au cours du conflit israélo-palestinien ont droit à des réparations. Lié à l’expulsion, le droit à « compensation », tel que compris dans la plupart des approches,
s’applique à une certaine catégorie de réfugiés, alors que, compris de manière générale, il s’applique à des personnes qui ne sont pas nécessairement comptabilisées parmi les réfugiés, mais sont cependant affectées par la perte de leurs biens ou des dommages affectant leurs vies professionnelles ou personnelles. Il n’y a pas de raison de ne prévoir ce droit que pour les victimes de certaines périodes. C’est le fait dommageable qui entraîne droit à réparation et non la date à laquelle il se produit. Il serait incompréhensible que dans une négociation portant sur les réparations dues aux réfugiés palestiniens, mention ne soit pas faite des réparations que méritent légitimement toutes les victimes palestiniennes des exactions commises par Israël en Palestine.
Toutes les situations doivent être examinées de manière à ce qu’une solution soit apportée à chacune. Un réfugié qui bénéficierait du droit au retour, épuise-t-il par là son droit à réparation ? Certainement pas. Il faut d’abord examiner s’il pourra obtenir la restitution de ses biens. Dans ce cas il sera cependant créancier d’un dédommagement, celui correspondant au tort qui lui a été fait par l’expulsion et pour les pertes de chance qu’il a subies de ce fait. Un réfugié qui n’exerce pas son droit au retour et ne recouvre donc pas ses biens, ou qui, exerçant son droit au retour, ne peut pas recouvrer ses biens parce qu’ils ont disparu ou été transformés de manière irréversible, doit, quant à lui, être indemnisé pour les biens perdus, mais aussi pour l’expulsion et pour les pertes de chance. Un Palestinien, non réfugié mais dépossédé de sa maison par destruction ou expropriation illégale, de ses champs ou de son commerce confisqués, une famille palestinienne ayant perdu l’un des siens, un blessé dont la vie est affectée ont droit à réparation pour la perte de l’un des leurs, pour la déstabilisation de leur vie et pour les biens perdus. L’élargissement de la problématique des réparations n’affaiblit pas la position palestinienne, elle la renforce.
Mais la preuve des torts, lorsque leur source remonte à plus d’un demi-siècle, est difficile à apporter en matière de biens. Les familles aisées ont davantage les moyens d’établir la preuve de leurs titres de propriété que les personnes d’origine modeste qui n’ont pas de « papiers » de famille. Quoiqu’il en soit, l’idée d’un « fonds de compensation » au montant limité ne correspondrait pas à l’application des normes juridiques évoquées plus haut. L’application rigoureuse des principes de responsabilité ne permet pas de limiter par avance le montant des dommages dus. Les considérations relatives à l’injustice affectant les personnes modestes qui risquent d’être moins bien dédommagées que les familles aisées qui ont les moyens d’établir leurs droits plus précisément, devront être réglées par les négociateurs (à moins qu’il ne s’agisse d’un organe judiciaire ou quasi-judicaire, nous allons y revenir). L’idée d’une somme forfaitaire est à écarter sauf dans les cas où les preuves desdommages subis seraient insuffisamment précises. Enfin il ne faut pas perdre de vue que, si d’innombrables individus sont concernés par le droit à réparations dans ce conflit, les institutions publiques le sont aussi. Le projet d’Israël depuis sa naissance est dirigé contre les Palestiniens comme individus parce qu’ils sont membres d’une collectivité unie autour d’un projet national. Dans les violences et agressionsmenées depuis 60 ans beaucoup l’ont été contre des biens publics, contre des institutions. Il y a là tout un volet du problème des réparations qui suppose une part de réparations collectives destinées à l’État de Palestine.
Les difficultés ne sont pas épuisées. Il reste des questions délicates : qui paiera ? qui tranchera parmi les estimations des dommages qui sont très variables et prendra donc la décision de fixer les montants ? enfin, à qui les sommes seront-elles allouées ? Les règles du droit de la responsabilité rappelées ci-dessus permettent d’apporter une réponse à la première question. Il revient à l’auteur des crimes et des dommages d’en supporter la charge. Dans son avis sur le mur construit par Israël dans le territoire palestinien occupé la Cour Internationale de Justice a été très claire sur ce point. Constatant que l’édification du mur était contraire à diverses obligations internationales et qu’ainsi cette construction engageait la responsabilité internationale de l’État d’Israël la Cour a constaté que cet État avait l’obligation « de réparer tous les dommages causés à toutes les personnes physiques et morales concernées…. » et « .. est tenu de restituer les terres, les vergers, les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique et morale en vue de l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé ». La Cour, constatant que parmi les obligations violées figurent des obligations erga omnes, formule ensuite les obligations qui pèsent sur les autres États et sur les Organisations internationales. Cet avis est malheureusement resté sans suite concrète par l’indifférence dans laquelle se complaît Israël face à ses obligations. Mais il y a là une raison de renouveler la pression pour que le droit retrouve sa place.
Le raisonnement de la Cour, élaboré en relation avec les conséquences juridiques de l’édification du mur, est transposable par analogie aux dommages causés aux Palestiniens par les guerres et l’occupation. C’est pourquoi l’idée récurrente d’un Fonds International d’indemnisation auquel devrait participer d’autres États est-elle juridiquement discutable. Une fois la paix rétablie, que des États tiers apportent leur soutien au peuple palestinien pour la reconstruction de la Palestine, cela va de soi et d’ailleurs l’Union Européenne par exemple (mais ce n’est qu’un exemple) soutient déjà à un haut niveau de financement l’Autorité Palestinienne. Mais ce soutien ne saurait être confondu avec une quelconque participation aux réparations dues pour des torts précis. Ces réparations reviennent à l’auteur des torts et à lui seul. L’argument est parfois avancé à juste titre que les Juifs après la Seconde Guerre Mondiale n’ont pas songé à demander à d’autres qu’à l’Allemagne de leur payer les réparations dues. Certains s’interrogent sur la capacité de l’économie israélienne à absorber une dépense qui risque d’être d’un montant écrasant. Mais l’argument est inutilement paralysant. L’économie israélienne dispose des capacités suffisantes. Elle s’est beaucoup enrichie de toutes les appropriations indues faites aux dépens des Palestiniens et elle peut emprunter pour faire face à cette charge.
Le point très délicat de savoir quelle autorité sera habilitée à évaluer les dossiers présentés et à décider des réparations mérite d’être examiné à la lumière d’expériences passées. Tout concourt compte tenu des difficultés interrelationnelles entre Israéliens et Palestiniens à confier cette tâche à un organisme international. C’était d’ailleurs déjà la perspective adoptée par l’Assemblée générale en 1948, puisque c’est une Commission de Conciliation pour la Palestine qui avait ce rôle dans le projet de la Résolution 194. Le sujet est si sensible et l’enjeu d’une telle importance, financière et politique, qu’il apparaît que seul un organe de nature juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle pourrait disposer de l’autorité nécessaire pour régler la question. Des leçons peuvent être tirées d’expériences comme celles du Tribunal irano-américain de réclamations ou de la Commission de compensation qui avait été chargée par le Conseil de sécurité de régler le contentieux entre l’Irak et le Koweit après la Guerre du Golfe de 1991. L’organe désigné devra fixer, préalablement à toute décision, les critères qui guideront son travail. Le droit international de la responsabilité doit être la référence constante et la recherche de l’objectivité en être la méthode. Parmi les questions préalables, il sera nécessaire de trancher la manière de régler les estimations de biens immobiliers. Il serait contraire au droit et à l’équité de les évaluer sur la base de leur prix au moment de l’expulsion. Si ces biens ont acquis aujourd’hui une très forte valeur par l’effet de la montée des prix dans le domaine immobilier, rien ne permet de priver les propriétaires dépossédés depuis des décennies de cet accroissement du prix de leurs biens. Une fois fixé le contenu des réparations sur la base du droit, il restera encore la question des modalités concrètes de réalisation. Il apparaît comme normal que les attributions aux particuliers, comme à certaines collectivités publiques palestiniennes, soient gérées par l’Autorité Palestinienne (qui, dans l’hypothèse d’un règlement des réparations inscrit dans un accord de paix serait devenu l’État de Palestine). Toutefois, une partie des réfugiés palestiniens choisira sans doute de ne pas exercer son droit au retour et demeurera donc dans des pays tiers. Pour éviter d’avoir à passer par les gouvernements de ces pays, ce qui pourrait être une source de difficultés et même pour éviter toute contestation à l’intérieur de la Palestine elle-même, il sera important qu’un organisme international indépendant assiste les autorités de Palestine dans cette mission.
V – L’échec des tentatives entreprises jusqu’ici pour apporter une solution au problème des réparations met en lumière les défaillances des mécanismes contemporains d’application du droit international. Dans le cadre des négociations entre Palestiniens et Israéliens, jamais la question des réparations n’a abouti à l’esquisse d’une solution. Dans la dernière étape de ces négociations qui eut lieu à Taba en 2001, la question du retour a dominé les débats relatifs aux réfugiés et lorsque les Palestiniens abordèrent le problème de la restitution des biens, ils essuyèrent un refus de la part des Israéliens.
Il est vrai qu’une démonstration de la possibilité de négocier un accord de paix avait été donnée en 2003 avec le projet d’accord de Genève conclu entre deux délégations nonofficielles menées du côté israélien par Yossi Beilin et du côté palestinien par Yasser Abd-el- Rabbo. L’article 7 de ce projet traite de la question des réfugiés. Il pose d’abord le principe des compensations pour les réfugiés indépendamment de leur lieu de résidence et celui du droit des États qui ont accueilli des réfugiés à une rémunération (paragraphe 3). Il fixe lesrègles qui permettront de déterminer les sommes dues à chacun en ayant recours pour cela à une Commission Internationale assistée d’un panel d’experts (paragraphe 9). Il prévoit, de surcroît, une compensation pour la situation générale de réfugiés à travers un Fonds destiné au développement communal et aux commémorations (paragraphe 10). Enfin, il crée un Fonds International qui recevra les contributions prévues en provenance d’Israël et des sommes additionnelles de la communauté internationale (paragraphe 12). Bien que la contribution d’Israël à ces réparations soit prévue, le projet d’accord ne règle pas tout et, se situant dans le cadre d’une négociation, il ménage Israël sur le terrain de sa responsabilité.
Le bilan à ce jour, démontre amplement la dureté des conditions de négociations tant que les Palestiniens sont confrontés à Israël sans l’intervention et l’appui de tiers objectifs. C’est pourquoi il nous semble nécessaire de changer de terrain et d’examiner quelles sont les possibilités qui existent dans un cadre proprement juridique, même si les possibilités de ce côté, sont assez limitées. S’il est vrai que dans la théorie, la notion de responsabilité internationale de l’État a progressé, les possibilités de la mettre en oeuvre restent réduites en raison de la nature volontariste de la justice internationale. Le principe de souveraineté des États entraîne en effet la liberté pour un État de refuser d’accepter la compétence d’une juridiction internationale. Ainsi, bien des cas de responsabilité internationale d’un État n’ont jamais été réglés juridiquement. Et la notion de réparations de guerre relève encore malheureusement de l’utopie. La création de la Cour Pénale Internationale a suscité beaucoup d’espoirs. Toutefois son statut limite les possibilités de saisine. L’Autorité Palestinienne a tenté en janvier 2009 une démarche d’adhésion à ce statut dans la perspective d’attraire devant la Cour les crimes commis pendant l’opération menée par Israël contre Gaza en décembre 2008 et début 2009. Il est trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra de cette démarche. Si elle aboutissait, la Cour pourrait statuer pénalement contre les auteurs des crimes, mais aussi décider de réparations pour les victimes.
La compétence universelle pourrait être une autre possibilité. Elle permet selon l’article 146 des Conventions de Genève de saisir les tribunaux de n’importe quel État de violations des Conventions quelle que soit la nationalité de l’auteur des crimes ou celle des victimes. Comme pour les juridictions internationales, un tribunal pénal interne, saisi pour juger de crimes internationaux, peut sur constitution de partie civile des victimes, décider de leur attribuer des réparations. Mais le principe de compétence universelle souffre des lenteurs ou réticences des États à l’incorporer à leur droit pénal. Plusieurs plaintes ont été déposées contre des responsables israéliens qui ont suffi à inquiéter les individus concernés, mais n’ont pas encore abouti. Il s’agissait de plaintes concernant des évènements récents. Mais l’on sait que les crimes internationaux étant imprescriptibles, il serait possible aujourd’hui d’assigner devant les juridictions pénales d’un État dont la législation s’y prête, les auteurs parmi ceux encore vivants des crimes de 1948 ou de périodes postérieures.
Cette voie est cependant très aléatoire. Devant cette situation, et devant le fait que les négociations permettent bien peu d’espoir, il ne reste que la piste d’un Tribunal International pour juger et réparer les crimes commis par Israël. Les expériences des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda peuvent servir d’exemple. Il est vrai que dans ces deux cas, la création a été le fait d’une résolution du Conseil de sécurité et que celuici est dominé par des États qui ne permettront pas la même démarche au profit de la Palestine. Mais l’Assemblée générale dispose elle aussi d’un pouvoir de création d’organes subsidiaires (article 22 de la Charte). Si elle était réunie en Assemblée générale extraordinaire sur la base de la résolution 377 qui lui permet de se substituer au Conseil de sécurité lorsque ce dernier est paralysé par le veto, elle pourrait procéder à la création d’un Tribunal Pénal International pour la Palestine. La crédibilité du droit international dans la société mondiale est à ce prix. Monique Chemillier-Gendreau Professeur émérite à l’Université Paris Diderot.
Click here to download Monique Chemillier-Gendreau Academic Paper:
Academic Paper: L’application des règles du droit international à la question du droit à réparation dans le règlement du conflit israélo-palestinien ![]() (16 page, 279 KB )
(16 page, 279 KB )
* Prof. Monique Chemillier-Gendreau: Professeur émérite de droit public et de science politique à l’Université Paris Diderot. Elle a participé à diverses procédures d’arbitrages devant la Cour Internationale de Justice et a été consultante auprès de l’Office des normes juridiques de l’UNESCO. Elle est la présidente d’honneur de l’Association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l’Homme dans le monde (AEJDH). Elle est membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine, dont les travaux ont été présentés le 4 mars 2009.
* This paper was originally presented at al-Zaytouna conference “Israel & the International Law” in 2009. We, in al-Zaytouna Centre, found this paper is still of importance and interest to researchers and scholars, who are following the situation in Gaza Strip.
Al-Zaytouna Centre for Studies and Consultations, 9/9/2014
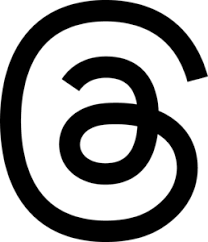

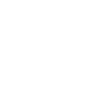
Leave A Comment